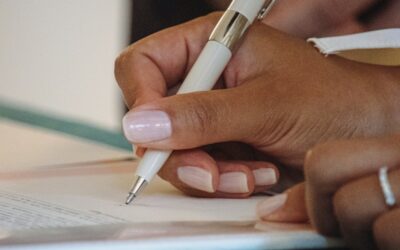Commentaire de la décision du Conseil d’Etat du 30 juin 2025, n° 494973
Un seul délai
Pour les gouverner tous
Nombre de commentateurs ont pour habitude de caractériser les procédures devant les juridictions administratives comme de véritables parcours d’obstacles, chaque obstacle manqué étant une cause d’irrecevabilité potentielle de la demande.
Si de très nombreux obstacles existent effectivement👮♂️ – pour n’en citer que quelques-uns, obligation de notification du recours contre un permis de construire (Article R. 600-1 du Code de l’urbanisme), obligation d’annexer la décision contestée à la requête, obligation de transmettre un titre de propriété lors de l’envoie d’une requête contre une autorisation d’urbanisme (Article R. 600-4 du Code de l’urbanisme), obligation d’énoncer la disposition légale au soutien d’une demande qui doit elle-même être suffisamment précise (Cour administrative d’appel de Bordeaux, 5 avril 2017, n° BX00764) – 🥇le principal obstacle est, incontestablement, l’obligation de respecter les délais légaux de recours contentieux (Article R. 421-2 du Code de justice administrative).
Au titre de ces délais prédomine le délai de recours de deux mois, opposable tant aux recours dits « gracieux » (ou « hiérarchique »), c’est-à-dire aux recours amiables pouvant ou devant précéder une action contentieuse, qu’aux recours dits « contentieux », c’est-à-dire aux recours devant les juridictions administratives.
Bref, tout recours introduit passé ce délai de deux mois sera automatiquement considéré comme irrecevable.
A ce stade, la chose semble relativement simple pour éviter de subir les foudres d’une irrecevabilité : envoyer son recours dans le délai de deux mois.
La difficulté – « le diable se cachant dans les détails » – apparaît pourtant aisément à la simple lecture de cet énoncé : « envoyer son recours ».
En effet, qui dit envoyer dit deux actions indépassables : l’expédition du recours et sa réception par l’autorité compétente ou la juridiction administrative.
Or qui de l’expédition ou de la réception prévaut dans le cadre du calcul du délai de deux mois ?
La réponse à cette question apparaît essentielle tant de nombreux recours sont expédiés avant la fin du délai de deux mois mais reçus après la fin de ce même délai, rendant donc irrecevables des recours pourtant transmis dans les temps.
🔎Cette distinction apparaît d’autant plus importante compte-tenu de l’importance que revêt un recours gracieux, ou hiérarchique donc, lequel a pour conséquence – si ce n’est de trouver une issue amiable au litige avant toute saisine d’une juridiction administrative – de proroger le délai de recours contentieux, ce dernier recommençant à courir dans son intégralité à partir de la notification du rejet du recours amiable au requérant (l’article L. 411-7 du Code de justice administrative précisant, à ce titre et pour rappel, que le silence gardé pendant plus de deux mois suite à l’envoi d’un recours administratif par l’administration vaut décision de rejet).
Pendant plusieurs décennies, la jurisprudence du Conseil d’Etat était limpide à cet égard : la seule date à prendre en compte était alors la date de réception du recours par l’autorité compétente ou le tribunal administratif (Conseil d’Etat, 27 mars 1991, n° 114854).
🛑La plus grande des vigilances s’imposait donc afin de s’assurer de la bonne recevabilité de son recours.
🥇Un premier revirement est intervenu en 2005 lorsque le Conseil d’Etat a consacré la date d’expédition comme seule date à prendre en compte (Conseil d’Etat, 27 juillet 2005, n° 271916).
Ce revirement ne s’imposait toutefois qu’aux recours administratifs préalables obligatoires (RAPO), lesquels ne concernent que des contentieux spécifiques (contentieux fiscal notamment ou encore certains contentieux de la commande publique).
Les recours gracieux facultatifs demeuraient donc soumis à l’empire de la date de réception, occasionnant de nombreux dysfonctionnements où les administrés – qui avaient pourtant expédiés leurs recours dans les délais légaux – étaient néanmoins irrecevables du fait d’un retard imputable aux services postaux.
L’insécurité juridique était donc totale et l’absence d’harmonisation des délais, incompréhensible.
🥈La deuxième inflexion du Conseil d’Etat attendra près de 20 ans pour intervenir avec comme ligne de mire, cette fois-ci, l’harmonisation des délais opposables aux recours contentieux sur les délais opposables aux RAPO : la date d’expédition devenant alors progressivement la norme (Conseil d’Etat, 13 mai 2024, n° 466541).
Demeuraient dès lors isolés, tel le dernier village gaulois, les recours gracieux facultatifs, lesquels échappaient à cette harmonisation bienvenue.
🥉Le Conseil d’Etat n’a – heureusement – pas attendu 20 années supplémentaires pour parachever son revirement débuté en 2005 en harmonisant l’ensemble des recours sous la même date cristallisante, à savoir la date d’expédition :
« La date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai ».
Exit donc les retards postaux, c’est dorénavant – et quelque soit le recours, contentieux ou administratif -, la date d’expédition qui prévaut et ce au bénéfice tant de la sécurité juridique que du droit, pour chaque administré, de saisir les juridictions administratives.